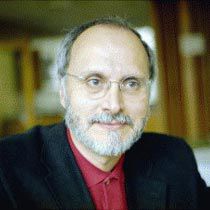Vingt ans après la chute du mur de Berlin, 18 000 kilomètres de nouveaux remparts vont bétonner les frontières partout sur la planète. Mesure de protection ou dangereux désir d’exclusion ? En lien ci-dessous, un entretien que nous avons publié récemment avec l’anthropologue Michel Agier, spécialiste des questions de migration.
Une nuit d’automne, le 9 novembre 1989, un mur est tombé dans la liesse. LE Mur. Erigé au centre de Berlin une nuit d’été, le 12 août 1961, par le gouvernement prosoviétique de la République démocratique allemande pour empêcher le passage à l’Ouest de la population, ce « mur de la honte » n’était pas seulement berlinois : il figurait aussi la division de l’Allemagne et de l’Europe décidée par les Alliés à la sortie de la guerre et, surtout, il incarnait violemment, concrètement - en béton armé, barbelés, miradors, vopos, kalachnikovs, morts et fusillés - le « rideau de fer » qui séparait le monde en deux blocs étanches.
La chute du Mur fut donc filmée, commentée, vécue comme la victoire sans partage du « monde libre » sur le communisme soviétique, bien que celui-ci ne se soit disloqué que deux ans plus tard : le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionnait de la tête de l’URSS, qui cessait officiellement d’exister. Voici l’événement décisif qui a bouleversé l’histoire.
Il restera malgré tout par l’image de ce mur ouvert, annonçant une ère radicalement nouvelle. On croyait alors à l’avènement d’un monde pacifié et sans frontières : économie globalisée, libre circulation des biens et des personnes, extension d’une Union européenne sublimant les Etats-nations. Vingt ans plus tard, la planète n’a jamais été hérissée d’autant de barrières infranchissables. Partout, d’autres murs se sont dressés pour non seulement signifier des limites - identitaires, territoriales, sociales, politiques -, mais encore et toujours séparer le monde en deux, entre « eux » et « nous ».
Dans un livre de 2007 (éd. Perrin, 252 p., 19 €), le géographe et diplomate Michel Foucher (1) analysait déjà cette « obsession des frontières » qui est devenue l’apanage du monde post-guerre froide : « Depuis 1991, écrivait-il alors, plus de 26 000 kilomètres de nouvelles frontières internationales ont été institués, 24 000 autres ont fait l’objet d’accords de délimitation et de démarcation, et si les programmes annoncés de murs, clôtures et barrières métalliques ou électroniques étaient menés à terme ils s’étireraient sur plus de 18 000 kilomètres. Jamais il n’a été autant négocié, délimité, démarqué, caractérisé, équipé, surveillé, patrouillé. » « Je soutiens que le monde, pour être viable, a besoin de frontières », ajoute-t-il. Mais pourquoi faut-il des remparts fortifiés, destinés à « rendre l’autre invisible » ? « On ne veut pas se voir, on ne veut plus les voir chez nous. »
Entre les Etats-Unis et le Mexique, Israël et la Cisjordanie, la Chine et la Corée du Nord, le Botswana et le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, l’Arabie saoudite et le Yémen, l’Inde et le Pakistan, le Bangladesh et la Birmanie, englobant le Cachemire d’une solide ligne de contrôle, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan, l’Union européenne et l’Afrique du Nord dans les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla sur la côte marocaine... partout, des murs bétonnent les frontières. Le marché est d’ailleurs prodigieusement juteux pour les entreprises qui se partagent construction, électrification, équipement technologique de ces barrières (notamment Elbit, l’entreprise israélienne chargée du mur de Cisjordanie, qui a décroché avec Boeing le contrat pour celui du Mexique). A cette liste, non close, il faudrait ajouter, souligne la politologue américaine Wendy Brown, les « murs dans les murs » qui fleurissent dans les villes des Etats-Unis, d’Afrique du Sud et d’ailleurs, cloisons étanches entre quartiers riches et pauvres, nationaux et immigrés. Fait remarquable : beaucoup de ces frontières murées résultent d’une décision unilatérale et non négociée, prise avec le soutien de leurs électeurs par des Etats démocratiques et développés à l’encontre de voisins indésirables (immigrants, terroristes, réfugiés politiques, pauvres, ou seulement étrangers, à mon identité nationale, à ma religion, à ma culture). Ces remparts de protection interdisent d’entrer, alors que celui de Berlin empêchait de sortir.
“Les murs ne sont pas construits
pour protéger, mais pour projeter
une image de protection.”
C’est ce que Wendy Brown appelle « la démocratie emmurée » dans un ouvrage qui fera date (Murs, Les murs-frontières et le déclin de la souveraineté des Etats, éd. Les Prairies ordinaires, en librairie le 15 novembre). Interrogée pour notre hors-série Télérama horizons : Le mur de Berlin, 20 ans après (en kiosques jusqu’au 2 décembre), elle voit dans cette « vogue des murs » le signe paradoxal du déclin de la souveraineté des Etats, qui concerne tous les Etats-nations de la planète, riches ou pauvres : « [Les murs] renvoient aux qualités des remparts médiévaux [...]. Tout cela au moment où la globalisation et les menaces miniaturisées érodent la puissance souveraine. Les murs ne sont donc pas construits pour protéger, mais pour projeter une image de protection. » Ce « désir de murs » serait, en d’autres termes, la maladie de l’individu perdu dans la globalisation, à la recherche d’horizons, de limites et de sécurité. Recherche bien légitime mais qui peut être vite récupérée, comme l’est la peur, pour désigner le coupable. La montée de la xénophobie est ainsi, selon Wendy Brown, le pendant du brassage des cultures et des populations qui se développe de fait, grâce notamment à Internet, à l’échelle planétaire. De la chute du Mur au désir de murs, c’est dire si les aspirations d’il y a vingt ans sont loin...
Ne contrôlant en réalité plus grand-chose dans une économie mondialisée, les chefs d’Etat sont tentés d’afficher leur efficacité par ces murs antimigratoires. Et pourtant, ils savent que jamais un mur n’a empêché les mouvements. Les armes biochimiques ou les épidémies, dangers réels qui menacent les Etats, ignorent les frontières, fussent-elles de béton armé. Quant aux flux des hommes, les barrières fermées les rendent seulement plus violents, plus dangereux, plus criminogènes. L’on sait déjà que l’existence de la palissade Mexique/Etats-Unis a intensifié le trafic des drogues et des migrants, alors que sa construction (comme en Israël) continue de coûter des sommes astronomiques.
“85 % des demandes d’asile
étaient acceptées en 1990,
85 % sont refusées depuis
le milieu des années 2000.”
« L’Europe de l’après-guerre froide, diagnostique l’anthropologue Michel Agier, trace ses limites en créant de la violence sur ses marges. » Depuis plusieurs années, il s’intéresse aux réfugiés (2), ce qui l’a d’abord mené loin, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient... et aujourd’hui à nos portes, à Patras en Grèce, l’un des points d’entrée dans l’espace Schengen, à Rome, à Paris, à Calais. Pour les 12 millions de personnes que la misère, la guerre, les dictatures condamnent aujourd’hui à l’exil, les murs ont d’abord l’aspect des clôtures du camp, refuge provisoire, administré par les organisations humanitaires, qui devient permanent. Aux portes de l’Europe, ce sont encore 250 centres de rétention, d’hébergement, zones d’attente qui les maintiennent « aux bords du monde ». « En quelques années, le droit d’asile, grande et belle idée du droit international d’après guerre, est, de fait, petit à petit enterré en Europe, constate Michel Agier, 85 % des demandes d’asile étaient acceptées en 1990, 85 % sont refusées depuis le milieu des années 2000. »
Lorsque la convention de Genève, sous l’égide de l’ONU, formalise le droit d’asile en 1951, c’est en pensant aux exilés juifs persécutés par le nazisme et aux dissidents des régimes communistes d’Europe de l’Est. La fin de l’asile est le mur auquel se heurtent maintenant ceux qui, Rwandais, Afghans, Algériens..., ayant connu des persécutions en raison de leur appartenance ethnique, religieuse, politique, sexuelle, auraient toute légitimité à l’obtenir aux termes de la convention de Genève. Partout, les politiques « antimigrants » se sont durcies, menées par des partis de droite comme de gauche au nom de la raison ou de l’impuissance - le fameux « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Face à eux, Michel Agier plaide pour un autre réalisme : « La mobilité des hommes est un mouvement irrépressible et mieux vaudrait l’accompagner que chercher à le réprimer. Tout humain veut rendre son séjour sur la terre vivable. En maintenant des millions de migrants hors de notre monde commun, on crée le désordre en voulant la mise en ordre. Il est réaliste d’affirmer que l’obstination à s’enfermer dans ses frontières, à cultiver l’entre-soi, ne tiendra pas. »
Et Wendy Brown conclut : « Un jour, les murs qu’on érige aujourd’hui pour nous protéger d’éléments dangereux ou étrangers deviendront inévitablement, eux aussi, des prisons. ».
Catherine Portevin
Télérama n° 3120
(1) Michel Foucher est le directeur scientifique de « Des frontières et des hommes », un nouveau festival interdisciplinaire. www.desfrontieresetdeshommes.eu
(2) Lire notamment Gérer les indésirables, Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire (éd. Flammarion, 352 p., 23 €). Michel Agier est l’un des auteurs de l’Atlas des migrants en Europe, dir. Olivier Clochard, réseau Migreurop (éd. Armand Colin, 144 p., 19,50 €).

 ache de Jérusalem
ache de Jérusalem








 Reconstruire le parti communiste italien, c'est maintenant ou jamais
Reconstruire le parti communiste italien, c'est maintenant ou jamais