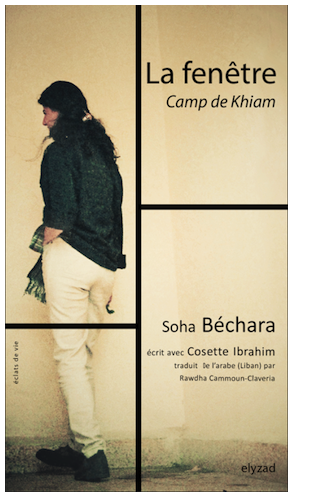Clio, la muse de l'Histoire
Colloque de l’ANACR 2B, « Histoire et mémoire de la Résistance , Bastia, 26 mai 2014
Georges RAVIS-GIORDANI
L’esprit de résistance en Corse
Dans la préface à son livre La Crise de la culture, Hannah Arendt fait référence au livre de René Char, Feuillets d’Hypnos, écrit pendant les années de résistance. René Char écrivait :
« Archiduc me confie qu’il a découvert sa vérité quand il a épousé la Résistance. Jusque-là il était un acteur de sa vie, frondeur et soupçonneux. L’insincérité l’empoisonnait... Une tristesse stérile peu à peu le recouvrait. Aujourd’hui il aime, il est engagé, il va nu.... ».
Reprenant cette image, H. Arendt écrit :
« Dans cette nudité, dépouillés de tous les masques – de ceux que la société fait porter à ses membres aussi bien que de ceux que l’individu fabrique pour lui-même dans ses réactions psychologiques contre la société – ils avaient été visités pour la première fois dans leur vie par une apparition de la liberté, non certes parce qu’ils agissaient contre la tyrannie et contre des choses pires que la tyrannie – cela était vrai pour chaque soldat des armées alliées – mais parce qu’ils étaient devenus des challengers, qu’ils avaient pris l’initiative en main et par conséquent, sans le savoir ni même le remarquer avaient commencé de créer entre eux cet espace public où la liberté pouvait apparaître »
Et elle revient à René Char :
« A tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s’asseoir. La place demeure vide mais le couvert reste mis »
On pourrait évoquer aussi ce qu ‘écrit A. Camus dans l’Homme Révolté :
« En même temps que la répulsion à l’égard de l’intrus, il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l’homme à une partie de lui-même ».
Je pourrais aussi évoquer ce passage d’Un Destin philosophique dans lequel Jean-Toussaint Desanti raconte comment il est passé de la résistance passive à la résistance active le jour où, devant le Commissariat du Panthéon il a vu des enfants juifs, parqués sur le trottoir en attente d’une déportation dont ils ne devaient pas revenir.
Je pourrais aussi évoquer le témoignage de quelques résistants qui disent comment ils sont entrés en résistance. Pierre Messmer par exemple ; je cite
« Pour moi le glas a sonné lorsque j’ai entendu à la radio la voix chevrotante de Pétain annonçant l’armistice ».
Ou encore Geneviève de Gaulle-Anthonioz : «Pour moi le début de la résistance ne fut pas l’appel du 18 juin que je n’ai pas entendu mais l’intervention du maréchal Pétain à la radio.... J’avais 19 ans, je n’arrivais pas le croire. A tel point que j’ai dit à mon père « C’est un type de la 5e Colonne qui se fait passer pour la Maréchal ».
Pour Dominique Lucchini, « Ribeddu », c’est un incident, une querelle avec un soldat italien qui le jette au maquis. On pourrait citer bien d’autres exemples du même type.
On le voit, le point de départ c’est souvent un choc émotionnel, un détail concret qui fait apparaître tout d’un coup comme radicalement inacceptable la situation dans laquelle on se trouve plongé.
Ces témoignages disent tous que l’entrée en résistance, tout au moins dans les deux premières années de la guerre, a été un choix personnel, une aventure dans laquelle on s’engage sans savoir où elle va nous mener mais en tout cas parce qu’il n’est pas possible de faire autrement. Ils disent mieux que je ne saurais le faire ce qu’était cet esprit de résistance, on pourrait presque dire l’instinct de résistance. Ils nous permettent de mieux comprendre pourquoi ces hommes et ces femmes ont pu aller, au péril et au prix de leur vie, jusqu’au bout de leur engagement.
Pour d’autres, le cheminement a été plus long et plus complexe. Pour le commandant en retraite François-Marie Pietri, ancien combattant, officier sorti du rang, la seule préoccupation en 1940 c’est d’éviter à tout prix que la Corse soit annexée par l’Italie ; il pense alors que Pétain et son gouvernement peuvent être le bouclier contre cette annexion, et c’est dans cet esprit qu’il crée la Légion corse, rassemblement de militaires s’engageant à se battre si besoin était contre cette annexion. Il va même jusqu’à se rendre à Vichy, où il prend des contacts avec le gouvernement pour obtenir des appuis et des armes. Son cheminement va passer par une série de désillusions : l’entrevue de Montoire d’abord en octobre 40, puis le retour de Laval comme chef du gouvernement en avril 42 et enfin l’invasion des troupes italiennes en novembre 42. Progressivement donc, la Légion corse va prendre le chemin de la lutte armée et le commandant Pietri va mettre sur pied dans sa région de San Gavino di Carbini, un maquis qui jouera un rôle dans les combats de septembre 1943.
Chez François Geronimi, né dans une famille de militaires, lycéen en 1940, le cheminement combine le patriotisme, héritage familial, et la révolte de l’adolescent contre le père, englué dans son attachement d’officier et d’ancien combattant au Maréchal.
Peu à peu, au fur et à mesure que la situation devient plus claire, au fur et à mesure que le rapport des forces se modifie, ces engagements individuels vont faire place à des engagements qui, tout en restant toujours individuels et uniques, vont obéir à des mouvements collectifs. C’est à ceux-là que je voudrais m’attacher.
***
Peut-on éclairer la Résistance en Corse en la confrontant à ce que nous savons de l’histoire et de la société de l’île ? N’étant pas historien, je me suis efforcé de faire une lecture ethnologique des travaux que j’ai pu consulter ; ceux d’H. Chaubin, S. Gregori, F. Pomponi, A. Rovere.
L’histoire de la Corse c’est celle d’une terre marquée depuis toujours par sa proximité géographique et culturelle avec l’Italie. C’est aussi celle d’un peuple intégré à la nation française dans une période cruciale de leur devenir, à l’une et à l’autre, le moment de leur histoire où la Corse et la France essaient de construire une nation dans la liberté.
Avant l'unification de 1860, qui estompe les différences entre les régions italiennes, on sait faire clairement, en Corse, la distinction entre d'une part la Toscane, ou les Etats du Pape, régions avec lesquelles les relations économiques et culturelles sont permanentes, connotées à l'image positive d'une italicité proche, et, d'autre part, Gênes, l'ancienne puissance dominante, vis à vis de laquelle les sentiments sont de ressentiment. Quand l'Italie fasciste revendique la Corse, c'est la France qui devient le pôle d'altérité positif, et d'autant plus que l'on est au lendemain de la guerre de 14-18 qui, par le sang versé, a resserré les liens entre l'île et la nation. Inversement, chaque fois que les Corses se penchent, dans le bilan de deux siècles de Corse française, sur la colonne "débit", l'italianité de la Corse peut redevenir un fantasme tentateur.
A la fin des années 1930, la revendication irrédentiste de l’Italie fasciste sur la Corse est d’autant plus menaçante que la Corse n’est pas intégrée physiquement au continent et qu’il y a dans l’île un mouvement politique qui prête une oreille complaisante à ces prétentions. Ce mouvement, bien que très minoritaire, faisant fond sur une aspiration naturelle à la reconnaissance de la culture et de la langue, dispose de moyens d’expression qui ne sont pas négligeables. Si la revue Corsica antica e moderna ou la page corse du journal de Livourne Il Telegrafo ne sont lues que par quelques abonnés, la revue A Muvra et son almanach annuel pénètrent dans beaucoup de foyers. Mais il faut minimiser l’influence de l’idéologie irrédentiste : elle ne touche avant la guerre que quelques milieux intellectuels. Elle prépare en revanche la collaboration en lui fournissant une justification idéologique.
Le 30 novembre 1938, des députés italiens réclament ouvertement l’annexion de la Corse, de la Tunisie et de la Savoie, déclenchant quelques jours après une vive réaction des Corses : plusieurs dizaines de milliers de personnes, (20 000 à Bastia) se rassemblent pour entendre ce qui est resté dans l’histoire sous le nom de « Serment de Bastia » :
« Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. »
La déclaration de guerre de l’Italie à la France, le 10 juin 1940, suivie 15 jours après par la signature d’un armistice et l’arrivée d’une délégation italienne chargée d’appliquer l’armistice, attisent les craintes d’annexion. Au mépris ancien pour le travailleur immigré italien s’ajoute maintenant le ressentiment et la rage que leur inspire cette déclaration de guerre annoncée alors que la France était déjà vaincue et ces « vainqueurs » qui en quinze jours de guerre ont été repoussés sur tous les fronts. Ils y ont même perdu, dans les Alpes, le fort construit à grands frais au sommet du Mont Chaberton (3 000 m.) qui menaçait Briançon.
Face à cette menace, le régime de Vichy se présente comme le rempart contre cette menace d’annexion. Certains, les plus nombreux, font confiance au Maréchal. D’autres, peu nombreux, placent leurs espoirs dans l’Angleterre qui continue la lutte et dans ce général inconnu qui l’a rejointe.
La situation est d’autant plus complexe que la Corse accueille sur son sol 17 000 Italiens dont un certain nombre sont d’antifascistes qui ont fui le régime de Mussolini ; d’ailleurs, en 1939, 500 d’entre eux ont demandé à être incorporés dans l’armée française. Sommés de souscrire une déclaration de loyalisme à l’égard de la France, la très grande majorité des Italiens signent cette déclaration.
Telle est donc la situation de la Corse. Rien, pendant les années qui vont suivre, ne va dissiper cette inquiétude qui, au contraire va aller en grandissant, surtout après l’entrevue de Montoire (oct. 40) et plus tard le retour au pouvoir de Laval (avril 42) dont on connaît les liens qui l’unissent à Mussolini.
Cette appréhension fonde paradoxalement à la fois l’adhésion à Vichy et l’attention à ce qui se passe du côté de l’Angleterre. Elle va être, pour les Corses, le ciment de la Résistance.
***
Je voudrais maintenant en venir à examiner ce qui dans la société corse telle qu’elle était en 1940, donne à la Résistance sa coloration propre.
Notons tout d’abord qu’en 1940 la démographie de la Corse est celle d’une société relativement jeune : 45 % de la population a moins de 30 ans et, bien entendu pour les hommes, les classes de 40 à 65 ans sont réduites par les pertes subies pendant la guerre de 14-18. Le contraste est donc fort entres les classes « jeunes » et les classes « vieilles ». Ce n’est pas là un trait original, il est propre à toute la France, mais il est important dans une société où le pouvoir, familial et politique, est traditionnellement entre les mains des plus âgés.
Sylvain Gregori note que ces classes jeunes sont délaissées par le système des clans qui fonctionne sur le vote groupé familial dont la décision revient aux chefs de famille. Il souligne toutefois que le Parti communiste a, dès les années 20, commencé à s’intéresser aux jeunes, en particulier à travers les mouvements sportifs les plus populaires (football et cyclisme) tout au moins dans les villes où il a une implantation, certes modeste. Il cite le cas de « l’Avenir cycliste » ajaccien qui a pour président Nonce Benielli, ou le « Le Vélo Club » de l’Ile Rousse dirigé par un communiste. A. Rovere insiste avec raison sur la force d’attraction que le PCF dans les années 1930 pouvait présenter pour des jeunes avides de nouveauté dans une société encire patriarcale. Il cite le cas de ce jeune homme, ouvrier à l’arsenal de Toulon qui en arrivant en vue de son village, « pour signifier à tous et d’abord à mon père que j’étais un homme libre », entonnait l’Internationale.
C’était encore plus vrai pour les jeunes femmes, comme le montre ce témoignage tout en nuances de Jéromine Benielli, élève institutrice à l’Ecole Normale d’Ajaccio à la fin des années 30 :
« Je suis une jeune fille bien élevée, habillée correctement, mais cette jeune fille bien élevée se permettra d’aller aux réunions communistes, de quêter dans la rue pour les réfugiés espagnols. Il faut du cran pour se démarquer des autres dans un pays où l’on vit beaucoup sous le regard du quartier, du village. L’émancipation sexuelle ? Ça ne nous traverse pas l’esprit. Aller aux réunions politiques c’est déjà très mal vu. Les quelques-unes qui se retrouvent dans ces réunions politiques sont des filles sages et non des dévergondées. Au siège du Parti, nous sommes deux ou trois. Une camarade de promotion puis une d’une autre promotion. Peut-être cinq jeunes filles au maximum »
Ce mouvement va, bien entendu, s’amplifier avec le Front Populaire. En 1938, la JC compte 500 membres.
Cette jeunesse va prendre une part importante à la Résistance.
Dans les villes les enseignants jouent un rôle important dans l’évolution des esprits des lycéens. Au sein du Parti communiste, en janvier 1941, Pierre George (Colonel Fabien) vient en Corse pour mobiliser la JC, qui, après son passage, devient de plus en plus active, notamment dans la distribution de tracts et le travail de mobilisation des lycéens suppléant même le Parti qui tâtonne à la recherche d’une ligne qui va aboutir en mai 1941 à la création du Front National. Ajoutons à cela que, à partir de 1942, la mise en place de « la Relève » puis du STO va orienter vers les maquis un grand nombre de jeunes hommes. Ce sont eux qui vont constituer l’essentiel des effectifs de la Résistance active et militaire.
***
Un deuxième trait caractéristique de la Résistance c’est la place qu’y tiennent les élites issues du peuple que sont les enseignants, les militaires de carrière et dans une mesure moindre mais qu’il faudrait sans doute ré-évaluer, le bas clergé.
En ce qui concerne les instituteurs (ils sont plus d’un millier) leur prestige, dans les villages se fonde non seulement sur le savoir dont ils sont détenteurs mais sur les fonctions qu’ils occupent dans l’administration et la vie quotidienne des communautés ; et aussi sur les services qu’ils rendent à l’occasion pour faciliter une démarche, pour aider un enfant en difficulté ou au contraire pour pousser un élève doué.
N’oublions pas surtout que les journées d’école commençaient par une leçon de morale et d’éducation civique et que c’était là l’occasion pour le maître ou la maîtresse d’exalter l’amour de la patrie ; la grande mais aussi la petite car les instituteurs avaient dans leur boite à outils pédagogique des manuels rédigés par des enseignants corse pour apprendre l’histoire et la géographie de la Corse.
C’est la même chose dans les villes, pour les professeurs, à ceci près qu’ils exercent leur influence sur des jeunes gens en âge de manifester, de s’engager ; faisant du lycée de Bastia un centre actif de la Résistance.
La liste serait longue de ces enseignants, hommes jeunes pour la plupart, frais émoulus de l’Ecole Normale ou des concours. Ils ont fourni les cadres du front National après avoir, pour certains d’entre eux animé et structuré dans les années trente le mouvement syndical : Jacques Bianchini, issu d’une famille de paysans est aussi fondateur du syndicat des travailleurs agricoles ; Laurent Salini a contribué à l’implantation de la CGT à Ajaccio ; Eugène Comiti est secrétaire du SNI et de la Ligue des droits de l’homme ; Antoine et Ange Stromboni et Séraphin Mondoloni sont membres de la CGTU.
Quant au clergé, nous savons peu de choses sur la part qu’il a prise à la résistance. Rappelons que Mgr Rodié, qui quitte Ajaccio en 1938, était résolument anti-irrédendiste. Mgr Llosa semble avoir navigué entre les écueils, mais le bas clergé donne des exemples de résistance. Maurice Choury évoque les deux curés de Cargèse et de Marignana qui aidèrent Pierre Griffi à trouver un lieu sûr pour installer son poste de radio. De même, à Sollacaro, le curé joue les médiateurs pour faire libérer plusieurs jeunes gens arrêtés par les Italiens.
Les anciens militaires de carrière jouent également un rôle important.. Beaucoup d’anciens militaires, officiers subalternes sortis du rang ou sous-officiers, vivent leur retraite dans leur village où ils jouissent d’un réel prestige. Profondément patriotes, anciens combattants, ils assurent souvent des fonctions électives. Maréchalistes en 1940, parce qu’ils voient en Pétain le garant de l’unité nationale, ils adhérent à la LFC, mais ils vont progressivement prendre leurs distances avec un régime qui s’enfonce dans la collaboration.
En juin 1940, les officiers chargés d’encadrer les forces militaires stationnées en Corse ne mesurent pas l’ampleur de la débâcle et veulent continuer le combat. A l’annonce de l’armistice, le général Mollard,gouverneur militaire de la Corse déclare à son état-major :
« Je ne reconnais pas le gouvernement du Maréchal ; je refuse de capituler et je vais défendre la Corse »
Il sera limogé et ne reprendra du service qu’à la Libération.
Devenus armée d’armistice, ces officiers vont continuer de songer à se battre si l’Italie annexait la Corse.
En novembre 1942, quand arrive l’ordre de démobilisation de l’armée d’armistice, ils planquent les armes ou les sabotent. Un certain nombre de ces militaires de carrière vont fournir les cadres de la Résistance lui donnant une coloration « militaire » plus prononcée que sur le Continent ; comme le capitaine Simon-Jean Giudicelli , d’abord responsable local de l LFC qui crée en 1943 le maquis de Chisà.
S. Gregori donne quelques chiffres : pendant l’été 1943, sur 26 postes de responsables militaires à l’échelon de l’arrondissement ou du canton, 18 sont occupés par des militaires.
***
Le troisième trait, qui est sans doute le plus important c’est le caractère essentiellement rural et villageois de la Corse des années 40 : 3 Corses sur 4 vivent dans des villages, souvent même dans des hameaux qui ne comptent que quelques maisons.
Autant dire que la dissimulation y est impossible. Tout se sait, tout se voit et au quotidien, la Résistance n’est donc possible qu’à la condition que chacun affecte à l’égard d’autrui une solidarité constante ou au moins ce qu’on pourrait appeler une indifférence affectée et dans le pire des cas, une tolérance armée. Car celui qui s’aviserait de dénoncer serait vite suspecté, découvert et sanctionné.
Ce que je dis là ne vaut que pour la période des premières années où les Corses sont entre eux ; c’est ainsi qu’on peut comprendre que dans ces années-là des rapports de gendarmerie puissent signaler que, à Ota, on a chanté l’Internationale dans un café, qu’à Aregno et Poggiolo le secrétaire de mairie organise l’écoute de Radio Londres, qu’à Montemaggiore on a crié « C’est De Gaulle qu’il nous faut, C’est Churchill qu’il nous faut, A bas Laval ». A ce propos le rapport de gendarmerie daté du 4 octobre 1942 dit très clairement les raisons multiples du mutisme que les habitants affichent devant les enquêteurs :
« La plupart des témoins entendus se sont montrés réticents pour des motifs divers (représailles, animosité envisagée, amitié, esprit du clan local qui semble dominer l’esprit national) »
Dès que les troupes italiennes s’installeront dans l’île, et pénètreront dans chaque canton, dans chaque village, ce ne sera plus possible mais l’esprit de résistance va prendre une forme qui pour être moins éclatante n’en sera que plus profonde. D’autant plus que, depuis octobre 1942, la menace du STO touche un grand nombre de familles et solidarise les communautés.
C’est ainsi qu’à Campile, la population s’oppose à la réquisition de jeunes gens, en présence du sous-préfet de Bastia et des gendarmes qui n’insistent pas. La solidarité communautaire joue également dans un certain nombre de cas quand le rejet de l’ennemi, est assez fort pour faire oublier un moment les anciennes luttes de clans, les vieilles inimitiés de familles ; ou quand un enfant du village sait entraîner derrière lui tout le village. C’est le cas à Porri, dont François Vittori est originaire, ou à Silvareccio, autour de Dominique Vincetti. A Sollacaro, pendant l’été 1943, François Geronimi et d’autres jeunes sont arrêtés pour avoir affiché des tracts qui dénonçaient des jeunes femmes du village soupçonnées de relations avec l’occupant ; aussitôt la population se rassemble devant la caserne des soldats italiens pour demander et finalement obtenir leur libération. S. Gregori note avec justesse qu’ici la communauté avait à choisir entre deux solidarités et qu’elle a choisi celle qui était la plus difficile à assumer.
Parfois l’homogénéité sociale des villages et l’étroitesse des liens de parenté facilitent plus encore cette solidarité. C’est notamment le cas dans le Sartenais qu’évoque Maurice Choury dans son livre Tous bandits d’honneur. Nous sommes là en effet dans une région où les oppositions de classes sont fortes et anciennes et se traduisent dans l’organisation de l’espace et de l’habitat : les « sgio » habitent Sartène, les « pastori » les petits hameaux et « pasciali » du bas-Sartenais.
« Toute la population de l’Ortolo est dans la Résistance. Des familles entières consacrent toute leur activité au ravitaillement, à la sécurité des hommes du maquis (*). Des propriétaires, tel Jean-Paul Polidori envoient des vivres. A Granace, chez le vieux Pasquin Leandri, on est sûr de trouver le gîte et le couvert et des guides, le plus souvent pieds nus mais qui vous accompagnent dans tout l’arrondissement s’il le faut. A Carabona, porte ouverte chez les Pietri, chez François Quilichini, chez les Giorgi,où le fils répare un poste de radio clandestin. Dans ce hameau on poursuit pendant plusieurs jours l’instruction militaire des jeunes réfractaires. A Gianuccio, où l’ennemi n’a jamais osé paraître, on fait en plein jour des tirs d’essai de fusils mitrailleurs parachutés dans la région de l’Ortolo et le plateau d’Ovace. A Castello di Baracci, Rosine et Toussaint Nicolaï sont de vrais anges gardiens pour les membres du Comité d’arrondissement (...) Cette région constitue un tel point d’appui pour la Résistance que le Comité d’arrondissement envisage d’en faire un véritable réduit militaire.
(*) Familles Paul et Charles Tramoni à Yena, Martinetti à Tozza-Alta, François Tramoni à Picchiogona, Pierre Tramoni à Paccialella di Cagna, Nicolaï et Félicien Tramoni à Foce, François et Antoine Cucchi à Radicci, Lanfranchi et Bocognano à Cillo, Giovangigli à l’ Ospedale, Baptiste Marcellesi à Porto-Vecchio
A Albertacce, dans une région qui n’est pas particulièrement caractérisée par les antagonistes de classes, le clivage entre « gaullistes » et « pétainistes » recouvre la séparation entre le village principal et le hameau lointain de Calasima .
Quand commencent les parachutages destinés à armer les patriotes, il faut mobiliser tout un village et parfois même plusieurs villages, hommes et mulets pour réceptionner les armes, les postes de radio, et les acheminer en lieu sûr. Pierre Simi dans un rapport que cite S. Gregori, indique de façon précise et concrète comment le village de Casta se mobilise :
« Les paysans de Casta non seulement guident les convois, mais mettent tout à notre disposition (10 décalitres d’avoine par jour pour les bêtes, une fournée de pain et un veau pour les hommes, tout le village est au courant). Les enfants font le guet, les femmes font le pain, les hommes de 15 à 60 ans vaquent ostensiblement à leurs affaires dans la journée. Les vieux conversent avec les Italiens, s’employant à connaître les heures et les directions des patrouilles, et chaque soir le même travail recommence ».
La Résistance se nourrit de ces liens de solidarité mais aussi des oppositions claniques et des inimitiés interfamiliales qui scandent la vie de ces communautés villageoises.
Vichy avait affiché dès 1940 sa volonté de dépasser l’esprit de clan au nom de la réconciliation de tous les Français dans l’effort de Révolution nationale. La Légion française des combattants, créée en août 1940, devait regrouper les anciens combattants et était conçue comme un des piliers de cette entreprise. A l’épreuve de la société corse il devait en être tout autrement et d’autant plus que dans la décennie qui précède la guerre les luttes politiques et sociales, l’essor du mouvement syndical, le Front populaire, l’émergence du Parti communiste ont aiguisé les oppositions claniques dans lesquelles, tout au moins dans les villages, ces luttes se sont exprimées.
A sa manière la structure clanique va contribuer à la naissance de l’esprit de résistance. Dans certaines communes, le maire landryste qui n’a pas (ou pas encore) été destitué par le Préfet mène contre la création de la LFC une lutte opiniâtre en dissuadant ses partisans d’adhérer à la Légion. Dans d’autres communes, au contraire, le maire landryste tente de noyauter la LFC.
S Gregori relate dans le détail le déroulement du conflit qui, de l’été 1940 au début de l’année 1942 oppose, à Venaco, le clan giacobbiste à la section locale de la LFC ; celle-ci vise la conquête du pouvoir municipal et accuse les giacobbistes d’être des « gaullistes ». Paul Giacobbi, protégé par le sous-préfet de Corte, Ravail (lui-même radical), manœuvre habilement, laisse aux jeunes du village, regroupés dans l’ »Association sportive de Venaco » le soin de mener une bataille d’escarmouches (graffitis, lazzis) contre la LFC et finit par éliminer ses adversaires. Ces péripéties s’inscrivent sur le fond ancien d’un républicanisme modéré mais solide, sur le prestige personnel de Giacobbi qui est, par ailleurs un des plus gros propriétaires fonciers du canton. Ils contribuent au développement de l’esprit de résistance en mobilisant chaque famille, chaque individu.
Comme le souligne S. Gregori, « il n’y a pas de place ici pour la zone grise »
Sauf exception, la solidarité familiale, nous le savons, est sans faille quand il s’agit de faire face à un adversaire étranger ; un résistant, dès lors qu’il est menacé, peut donc compter sur l’appui de sa famille, de ses parents, de ses amis, même s’ils ne partagent pas ses positions. S’ils les partagent, c’est sur cette base que se fait, de proche en proche le recrutement. Et c’est d’autant plus facile que le maquis n’est que le prolongement du village ; comme le fait remarquer A. Rovere, il n’y a pas de maquis en Corse ; on prend le maquis « chez soi », avec les avantages que ça représente ; seuls les responsables à un niveau élevé circulent.
La répression qui s’exerce sur les familles renforce le processus. Quand Ribeddu prend le maquis, son père et trois de ses proches sont arrêtés, ce qui le conduit à se constituer prisonnier pour obtenir leur libération. En prison, il fera la connaissance de plusieurs militants communistes qui vont donner à sa révolte un contenu plus politique. Il s’évade un mois plus tard et rejoint un maquis... où il retrouve son père ! Il conclut son témoignage
« Mes 38 jours de prison vont coûter cher à l’ennemi »
C’est sur la base de cette solidarité familiale et parentale que la Résistance recrute.
C’est aussi dans ce cadre familial élargi que les femmes prennent une part active à la Résistance ; en tant que mères ou épouses, elles tirent même parti de leur statut, du respect qu’on leur doit pour protéger les maquisards, accueillir les cadres en mission arrivant du Continent, de Londres ou d’Alger, cacher ou transporter armes et vivres.
Mais leur activité ne s’arrête pas là ; dans les villes, où le ravitaillement est défectueux, le marché noir omniprésent, elles savent se grouper pour protester et réclamer, faisant ainsi l’apprentissage de l’organisation collective. C’est ainsi qu’en septembre 1942, à Ajaccio, les ménagères menacent, si le ravitaillement n’est pas assuré, de s’en prendre elles mêmes aux magasins. A Bastia, les 22 et 23 mars 1943, elles manifestent, rejointes par les lycéens et une partie de la population contre les difficultés du ravitaillement, si bien que la manifestation rassemble entre 1 000 et 2 000 personnes ; la police intervient. A Corte, en juillet 1943, une femme appelle les autres à brûler les magasins.
***
Quel a été le ciment, ou plutôt le ferment, de cette Résistance qui a pu faire se lever, en septembre 1943 plus de 10 000 hommes pour aller au combat ?
Est-ce encore l’italophobie ? Sans doute a t-elle eu un rôle important pour entretenir, tout au long de ces trois années d’attente, le moral de la population. Mais elle joue moins au moment décisif, d’abord parce qu’au fil de l’année 1943, les Corse ont appris à faire la différence entre « les soldats du Roi », des hommes du peuple embrigadés de force dans l’armée et qui ne songent qu’à « tornare a casa » et « l’armée de Mussolini », les carabiniers et les chemises noires. En septembre 1943, c’est surtout les Allemands de la 90e Panzer Division (36 000 hommes aguerris et bien armés) qu’il faut combattre, tandis qu’une partie de l’armée italienne se range aux côtes des résistants et des troupes françaises. Et les troupes italiennes paieront un lourd tribut à ces combats : plus de 600 soldats tués.
Si la résistance s’est propagée dans toute l’île comme le montre la carte des terrains de parachutage, c’est d’une part parce que le tissu social était formé essentiellement de ces petites communautés villageoises fonctionnant sur la principe de la solidarité antagoniste (même les citadins se référaient toujours à un village) et c’est surtout parce que le PCF a su définir et imposer, avec le FN, une organisation assez large et assez souple pour que tous les groupes et réseaux rattachés au Continent ou à Londres et Alger viennent s’y fondre ; cette unification, provisoire certes, mais nécessaire pour entraîner l’ensemble du peuple corse, ne devait pas durer au-delà de la Libération. On connaît la suite : très vite l’élimination politique de Giraud, et plus tardivement la bataille autour du pouvoir politique à partir des élections de 1945.
L’esprit de résistance devra aller habiter ailleurs, dans le travail de la mémoire et de l’histoire. Et pour finir, sur une note grave mais une note d’espoir, un dernier texte de René Char :
« Vous tendez une allumette à votre lampe et ce qui s’allume n’éclaire pas. C’est loin, très loin de vous que le cercle illumine ».